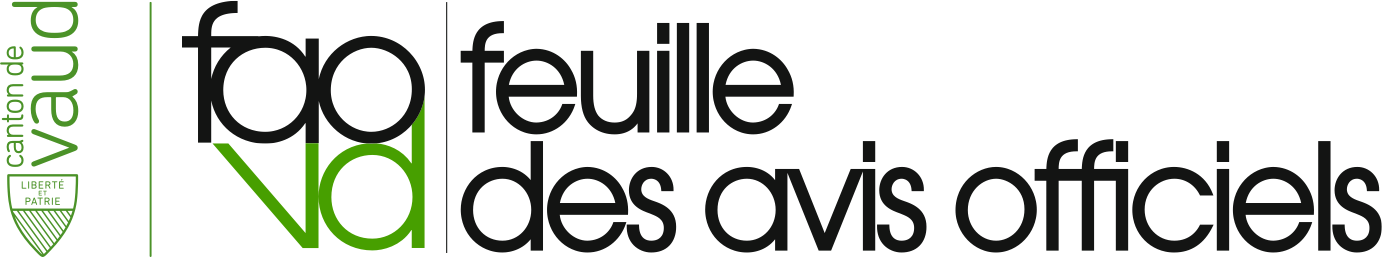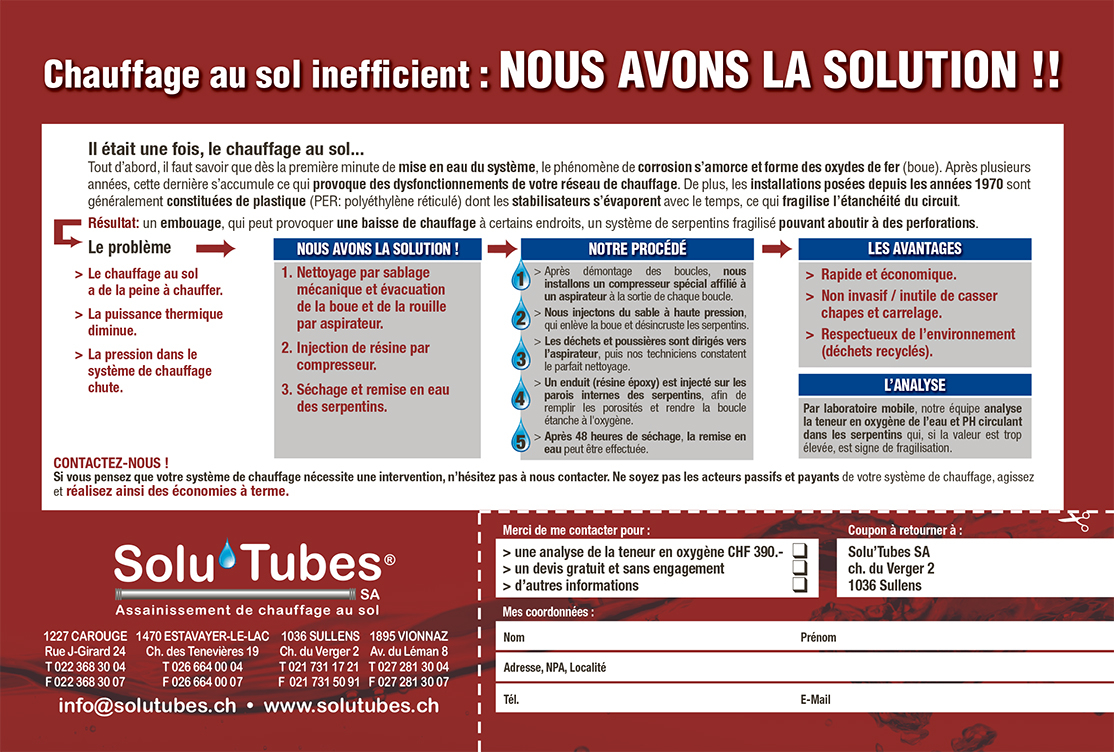À la croisée des enjeux de santé publique et de cohésion sociale, les métiers du domaine santé-social occupent une place stratégique dans le système de formation professionnelle vaudois. À travers l’organisation du monde du travail Aoris, pas moins de 33 professions sont représentées, de l’assistante en pharmacie CFC au travailleur social HES, en passant par l’aide en soins et accompagnement (ASA), l’assistant en soins et santé communautaire (ASSC), le technicien en salle d’opération (lire encadré) ou encore l’infirmière HES.
L’apprentissage au cœur
Aoris organise chaque année les cours interentreprises pour près de 1900 apprenties et apprentis des filières ASA, ASSC et ASE : des cours qui viennent compléter la formation dispensée en entreprise et en école professionnelle. Elle est également un acteur fédérateur qui collabore étroitement avec les institutions formatrices, les services de l’État et d’autres partenaires pour rendre ces métiers plus visibles et attractifs auprès des jeunes, des adultes en reconversion ou encore des personnes migrantes. À cela s’ajoute la gestion des commissaires professionnels, acteurs clés du suivi des apprentis en entreprise. Parmi les dispositifs complémentaires figure aussi le Groupement pour l’apprentissage (GPA), avec ses coachs spécialisés (Coachapp) qui interviennent à la demande de l’apprenti ou de l’entreprise, pour renforcer l’autonomie et les capacités d’organisation et de formation de l’apprenti.
De beaux métiers à revaloriser
Porteurs de sens, d’engagement et de solidarité, ces «métiers de l’humain» peinent pourtant à masquer une publicité négative qui leur est faite, notamment à cause de la surcharge de travail ou la parfois faible reconnaissance salariale. Comme le relève l’Observatoire suisse de la santé, «à l’horizon 2030, près de 2000 à 2500 infirmières et infirmiers ainsi qu’environ 450 assistants et assistantes en soins et santé communautaire (ASSC) devraient manquer dans les hôpitaux, les cliniques, les EMS ou les institutions spécialisées du Canton de Vaud». Mais le cœur de ces métiers garde toute sa pertinence. «Ce sont des professions humaines, de sens, où l’on ne risque pas le chômage, et qui offrent de nombreuses possibilités d’évolution professionnelle», insiste Anne Oppliger, secrétaire générale de l’association Aoris. Le schéma de progression peut aller du niveau AFP jusqu’aux titres HES, en passant par le CFC et les maturités professionnelles. Certaines personnes formées deviennent à leur tour formatrices en cours interentreprises. «Mais il ne faut pas non plus systématiser la montée en gamme, nuance-t-elle. Nous avons aussi cruellement besoin de vrais professionnels qui aiment accompagner au quotidien; il en va de la qualité de vie des bénéficiaires.»
Une affirmation d’autant plus importante que la reconnaissance du niveau CFC dans ces domaines reste parfois inférieure à celle d’autres filières artisanales ou techniques. La crainte de s’engager pour ces métiers ne tient pas qu’aux conditions de travail, mais aussi aux discours ambiants, alerte Anne Oppliger. «Il arrive que des professionnels déconseillent leur métier à des jeunes en stage…» Un travail culturel est donc aussi à mener pour réhabiliter l’image de ces professions et en souligner la richesse. La démarche d’Aoris se veut résolument collaborative. «Ce n’est ni aux seuls employeurs, ni aux seuls formateurs, ni à l’État de tout résoudre. Il faut agir ensemble», résume-t-elle. La relève de demain se joue dès aujourd’hui, au croisement de l’envie des personnes en formation, des professionnels expérimentés et des personnes à soigner et à accompagner.
Investpro: promotion des soins infirmiers
Dans cet esprit, l’un des projets phares lancé en 2024 est le programme Investpro, porté par le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS) et le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF). Doté d’un budget de 90 millions de francs, il s’articule en trois axes qui ont pour objectif de rendre plus attractives les filières en soins infirmiers : la formation, les conditions de travail et la promotion.
Ce dernier volet, confié à Aoris, cible prioritairement les 12/16 ans, avec neuf mesures innovantes qui vont du recensement des attentes des jeunes quant à leur avenir professionnel à la création d’une campagne de communication à leur intention en passant par l’augmentation des capacités d’accueil de stagiaires dans les institutions… Au mois de juin, en collaboration avec le Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV), une équipe d’apprentis de 3e année en CFC et une équipe d’apprentis de 2e année en FPA (formation professionnelle accélérée) ont été récompensées pour leurs projets à la suite d’un concours organisé par Aoris afin de créer des supports promotionnels (vidéos, affiches ou fascicules) à destination d’autres jeunes pour promouvoir les métiers des domaines de la santé et du travail social. «C’est du travail par les jeunes pour les jeunes, et cela a donné des slogans vraiment impactants qui pourraient nourrir une future campagne cantonale», se réjouit Géraldine Dubuis, cheffe de projet. Autre mesure en développement: une valise pédagogique destinée aux enseignants, qui permettra à des classes de rencontrer des professionnels et des bénéficiaires en EMS ou en institution proches de leur école, de partager un moment avec eux, puis de restituer cette expérience en classe à travers des exposés. Objectif de ce projet pilote qui devrait débuter au printemps 2026: susciter l’envie, démystifier les métiers et valoriser l’humain derrière les fonctions.
Des stages immersifs avant de se lancer
Comme le souligne à son tour Anne Oppliger, le but est que la bascule école – monde du travail se fasse de la manière la plus souple possible grâce à une découverte anticipée, le plus possible en amont et loin du stress. «Parce que les graines qui sont plantées le plus tôt ont le plus de chance, honnêtement arrosées, de donner une jolie fleur.» Depuis la crise sanitaire, Aoris a d’ailleurs pérennisé une initiative de stages intégrés aux cours interentreprises (stages CI), initialement conçue pour pallier l’absence de stages classiques assumés par les institutions. Destinés aux élèves de 10e et 11e années, ces stages d’observation de deux ou trois jours (entre octobre et juin) permettent de découvrir de l’intérieur les métiers d’ASA, d’ASE ou d’ASSC, au contact direct d’apprentis. «Ces échanges entre pairs, d’un âge proche, sont souvent très riches», note Anne Oppliger. En quoi consistent des soins corporels? Que signifie «mobiliser» une personne? Quelles méthodes créatives peut-on employer pour favoriser le bien-être psychique? Autant de thématiques autour desquelles les participants ont l’occasion d’expérimenter des gestes, sous la houlette de professionnels du terrain. À l’issue, ils reçoivent une attestation utile pour leurs recherches de places d’apprentissage. Le bilan? Ce sont entre 80 et 90 jeunes qui s’inscrivent à cette mesure pour apprendre à connaître trois métiers des domaines de la santé et du travail social. «Les jeunes sont très demandeurs et souhaitent faire plus de stages en institutions, mais les structures, surtout les petites, sont à bout de souffle: surcharge, manque de moyens humains, lourdeur administrative… Il faudrait systématiser l’accueil tout en allégeant la charge des encadrants», plaide la responsable. Il est essentiel que les jeunes aillent humer un peu ce qui se passe vraiment dans ces métiers.»